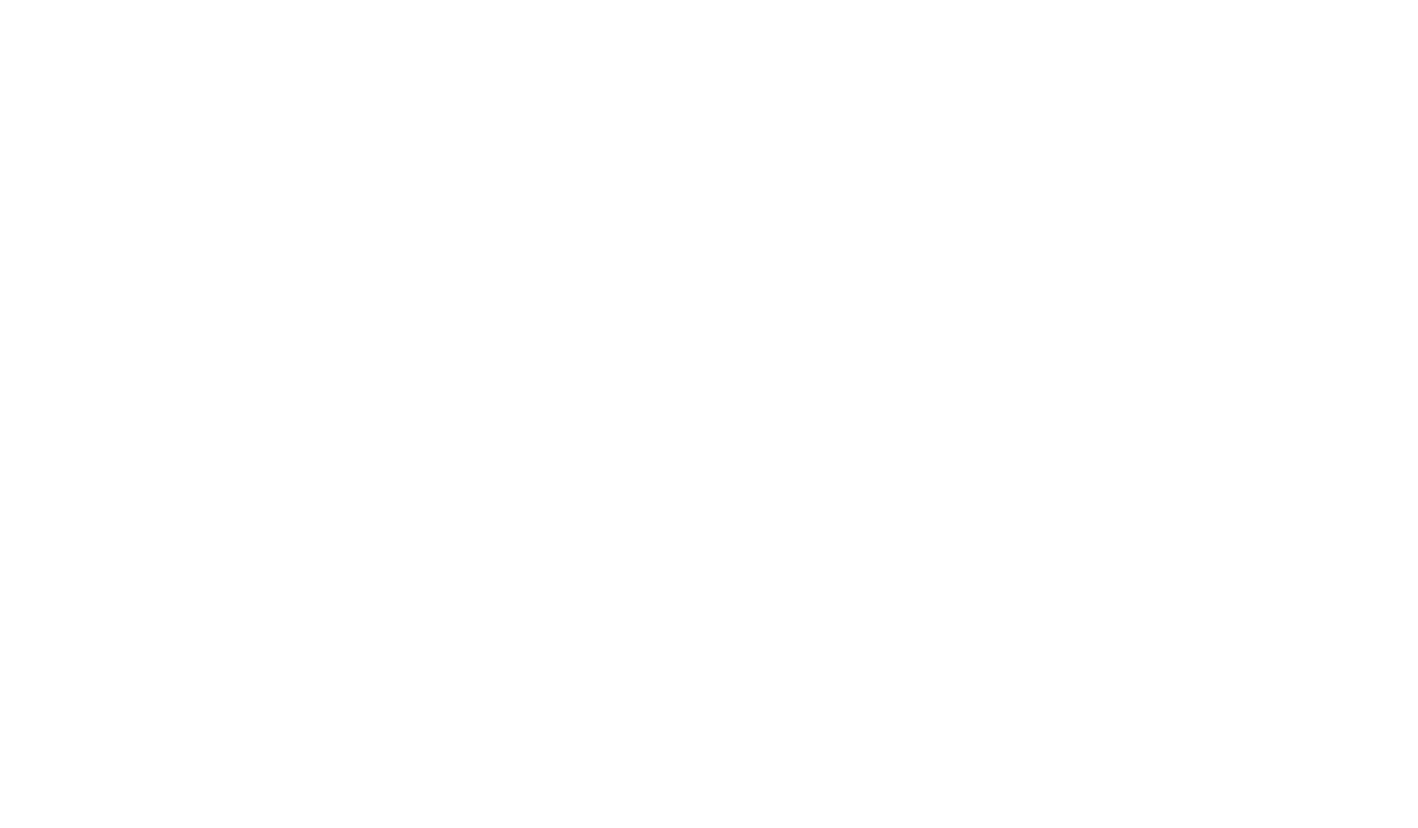« Le courage et la résilience n’ont pas de genre », déclare une conseillère municipale de Tchernihiv
À l’occasion de l’atelier « Amplifier les voix des femmes ukrainiennes dans la reconstruction post-guerre » organisé par Cities Alliance, le CCRE a été représenté par Nataliia Kholchenkova, membre du conseil municipal de Tchernihiv – une ville assiégée par la Russie pendant 39 jours au printemps 2022. Une interview a été réalisée par Cities Alliance avec Nataliia Kholchenkova pour discuter des efforts de reconstruction de la ville et du rôle que jouent les femmes dans ce processus.
Tchernihiv a été assiégée par la Russie pendant 39 jours au printemps 2022. Depuis, un processus de reconstruction a été engagé. Pourriez-vous nous partager l’expérience de la ville pendant et après le siège ? Comment la ville a-t-elle tenté de répondre aux besoins de relèvement, y compris en matière de traumatisme et de pertes humaines ?
Tchernihiv est une ville du nord de l’Ukraine, située à environ 100 km de la frontière avec la Russie et la Biélorussie. Dès le début de la guerre, la ville a été attaquée. Tchernihiv a agi comme un bouclier face aux forces russes en route vers Kyiv. Grâce à la résistance de nos citoyens, l’ennemi n’a pas pu progresser. La ville n’a pas été occupée, mais elle a été encerclée et soumise à des bombardements intensifs pendant près de 40 jours.
Tchernihiv a été fortement détruite et endommagée. Notre seul pont reliant la ville à Kyiv et au reste de l’Ukraine a été détruit. Cela nous a empêchés de recevoir toute aide humanitaire, et la ville a frôlé une véritable crise humanitaire. Nous avons vécu sans électricité, sans gaz et sans eau pendant environ deux semaines. Ce fut une période extrêmement difficile.
Le plus terrible, c’est que de nombreux habitants ont été tués. Presque chaque jour, nous apprenions la mort de nos voisins, amis, proches à cause de la guerre. L’un des problèmes majeurs était l’impossibilité d’enterrer les défunts. Sous les bombardements constants, il n’était pas possible de procéder à des funérailles. Il n’y avait plus de médicaments, et certaines personnes sont mortes faute de pouvoir se soigner.
Je tiens à souligner l’unité, le courage et la résilience de tous les habitants, qui se soutenaient mutuellement et partageaient les produits et médicaments disponibles. Il n’y avait aucune hésitation sur la manière d’agir : les hommes ont pris les armes et rejoint les forces armées ou les unités de défense territoriale locale, tandis que les femmes ont fait tout leur possible pour les soutenir – en fournissant nourriture, médicaments, vêtements, etc.
Quelles infrastructures et services ont été les plus touchés ? Comment la ville s’est-elle adaptée à leur absence ?
L’invasion russe a gravement endommagé les infrastructures sociales, critiques, et les logements. Environ 850 immeubles d’habitation collectifs ont été partiellement endommagés, 150 ont subi des dommages lourds dus à des frappes directes, et 5 ont été totalement détruits. Quelque 2 000 maisons individuelles ont été endommagées, dont 600 totalement détruites.
Les habitants partageaient tout entre eux, y compris leurs logements. Mais le pire, c’est qu’il n’y avait aucun abri. Nous n’étions pas préparés à la guerre. Au début du conflit, nous avons utilisé les caves et sous-sols comme refuges. Ce sont ces lieux qui ont servi de lieux de vie, car nous étions constamment sous les bombes, et il était trop dangereux de sortir pour chercher à manger.
Concernant les infrastructures critiques, la ville a vécu près de deux semaines sans eau. Le réseau centralisé d’eau potable a été endommagé. Sur cinq stations de pompage, deux ont été totalement détruites et deux gravement endommagées. Toute la ville – soit presque 300 000 habitants – était sans eau et sans système d’assainissement. Le chauffage urbain ne fonctionnait plus non plus. Il faisait froid, avec des températures descendant en dessous de zéro, atteignant parfois -7 °C. Il n’y avait plus d’électricité, donc aucun moyen d’utiliser des équipements électroniques, ni de téléphoner, ni de regarder les informations à la télévision ou sur internet. Nous étions complètement isolés dans les abris, uniquement accompagnés des autres personnes présentes. Mais nous avons dû survivre, coûte que coûte.
Comment les habitants ont-ils recommencé à vivre ? Comment les efforts de reconstruction ont-ils commencé ?
Pendant le siège, de nombreux habitants ont tenté de quitter la ville. Cela représentait un grand danger, et plusieurs civils ont été tués en essayant de fuir, car aucun corridor humanitaire ni conditions organisées de sortie n’étaient en place. Certaines voitures arborant des panneaux signalant la présence d’enfants et de familles à bord ont été ciblées par des tirs ennemis. C’était très dangereux, mais rester en ville l’était tout autant.
Avant la guerre, Tchernihiv comptait environ 284 000 habitants. Mi-mars, il n’en restait qu’environ 70 000. Après le retrait de l’ennemi, pendant l’été, les gens ont commencé à revenir. En septembre, environ 220 000 habitants étaient revenus. Bien sûr, il revenait au gouvernement local d’assurer la mise en place des mesures et services nécessaires à la reconstruction. Cela a aussi encouragé les citoyens à revenir.
Comment la reprise des moyens de subsistance s’est-elle organisée au retour des habitants ? Les femmes ont-elles assumé de nouveaux rôles, compte tenu de l’engagement des hommes au front ?
Je tiens à souligner le rôle des autorités locales dans le processus de reprise. Il a fallu prendre des décisions rapidement. La priorité a été de réparer les immeubles et les logements pour que les gens aient un toit, et de restaurer les systèmes d’eau et de chauffage avant l’automne et l’hiver. Il s’agissait d’un énorme travail de coordination pour fournir tous les services en même temps, et ce processus se poursuit encore aujourd’hui. Ensuite, nous avons commencé à construire de vrais abris, équipés de ventilation et de toilettes biologiques, dans les écoles et les immeubles.
Une autre action importante a été la réouverture des écoles et la reprise de l’enseignement en présentiel. Nous avons compris que les parents voulaient que leurs enfants retournent à l’école, et cela a fortement incité au retour. Désormais, l’enseignement est hybride, en ligne et en présentiel. Nous avons aussi rouvert les jardins d’enfants, tous équipés d’abris pour protéger les enfants en cas d’alerte. La reprise des structures éducatives était indispensable pour permettre aux parents de travailler. Sans garderies, les mères devaient rester à la maison.
Concernant les emplois, la situation reste difficile, car la plupart de nos entreprises étaient situées en périphérie — les zones les plus bombardées. Beaucoup de sociétés ont déménagé vers l’ouest du pays, plus sûr. Le chômage a fortement augmenté.
De nombreux hommes sont partis au front, et beaucoup de femmes se sont retrouvées seules à s’occuper des enfants. Il est très difficile de concilier emploi et garde d’enfants. Cela reste un problème, bien que des progrès aient été faits au niveau communautaire. Certaines organisations féminines offrent du soutien, mais trouver un emploi reste très compliqué avec tant d’entreprises fermées ou déplacées. Comme nous sommes une région frontalière, encore exposée à la guerre, il est difficile de convaincre des investisseurs de venir.
Notre mission, en tant qu’autorité locale, est de soutenir l’économie et de créer les conditions pour que les entreprises reviennent. Nous travaillons actuellement avec des partenaires internationaux pour attirer des investisseurs. Ces coopérations sont un signal positif pour nos habitants — cela leur montre qu’ils ont un avenir ici.
Quel a été le rôle de la société civile et des organisations locales dans les derniers mois de reconstruction ? Les femmes ont-elles pris de nouveaux rôles ?
Je souhaite souligner le rôle des organisations de bénévoles, composées en grande partie de femmes. Ces femmes ont énormément aidé en apportant de l’aide humanitaire, en rassemblant des fournitures pour les forces armées, et en soutenant l’éducation et la garde d’enfants.
L’éducation est essentielle. Elle offre un soutien psychologique crucial pour nos enfants confrontés à cette guerre terrible. La guerre cause non seulement des blessures physiques, mais aussi un traumatisme psychologique, surtout pour les femmes. Elles subissent une forte pression pour assurer la sécurité et la santé de leurs enfants, tout en travaillant. Cette charge mentale a doublé, voire triplé pendant la guerre. Le rôle des femmes a été tout simplement incroyable.
Ce que je peux affirmer avec certitude, c’est que le courage et la résilience n’ont pas de genre. Les femmes sont des leaders sur tous les fronts — éducatif, culturel, sanitaire.
Vous avez évoqué les traumatismes psychologiques. Des programmes de santé mentale ont-ils été mis en place par la ville ou des organisations locales ?
Oui, nous avons des programmes municipaux gérés par le Département de la politique sociale et un service d’aide aux personnes isolées. Nous travaillons aussi avec des organisations internationales liées à l’ONU.
Mais avec la guerre encore en cours, et la menace constante de bombardements, les femmes n’ont souvent pas le temps de s’occuper de leur santé mentale. C’est notre devoir, en tant qu’autorité locale, de leur rappeler qu’elles doivent prendre soin aussi de leur bien-être psychologique, non seulement pour elles-mêmes, mais aussi pour leurs enfants, collègues, conjoints, et la ville.
Quelle est la situation actuelle à Tchernihiv ? De quoi la ville a-t-elle le plus besoin en ce moment ?
Nous avons réussi à rétablir certains services essentiels. Les coupures d’électricité sont moins fréquentes. Nous avons équipé les écoles et infrastructures critiques de générateurs, ainsi que des entreprises. Nous organisons des activités pour les enfants. Mais il reste beaucoup à faire. Par exemple, l’éclairage public est toujours coupé pour économiser l’électricité : à 17h, il fait déjà noir dans les rues.
Ce dont la ville a le plus besoin, c’est d’un soutien financier pour la reconstruction à grande échelle. Avec notre budget municipal, nous avons pu réparer les dégâts légers et moyens, mais pas les destructions lourdes. Par exemple, nous souhaitons reconstruire deux stations de pompage, mais nous n’en avons pas les moyens. C’est également le cas pour le réseau de transport public endommagé. Nous aimerions intégrer des solutions technologiques européennes innovantes pour créer un meilleur avenir pour nos citoyens et améliorer leur qualité de vie.
Je peux affirmer que la participation des femmes à tous les niveaux d’activité et de prise de décision est plus forte aujourd’hui qu’avant, grâce à la coopération avec des organisations féminines internationales. Cela fait partie de notre processus d’intégration européenne, et c’est essentiel pour nous. Cela nous donne de la force et de la motivation pour nous unir en tant que femmes, à l’image de l’Union européenne, où de nombreuses femmes jouent des rôles majeurs en politique, dans l’économie et les affaires. Nous devons poursuivre dans cette direction.
Nataliia Kholchenkova est cheffe du département des relations internationales et des investissements au Conseil municipal de Tchernihiv. Depuis 2020, elle est également présidente de la Commission permanente sur les règlements, la légalité, la lutte contre la corruption, les libertés et droits des citoyens, ainsi que de l’association de députés « Pour l’égalité des droits et des chances » à Tchernihiv. Titulaire d’un doctorat en éducation secondaire de l’Université nationale T.H. Shevchenko « Collège de Tchernihiv », elle y a également été professeure associée. Elle est membre du conseil de l’Union des femmes de Tchernihiv, de l’Association des villes ukrainiennes (AUC), du Conseil des communes et régions d’Europe (CCRE), et porte-parole PLATFORMA pour l’AUC.

Chargé de projet – Partenariats internationaux (U-Lead)