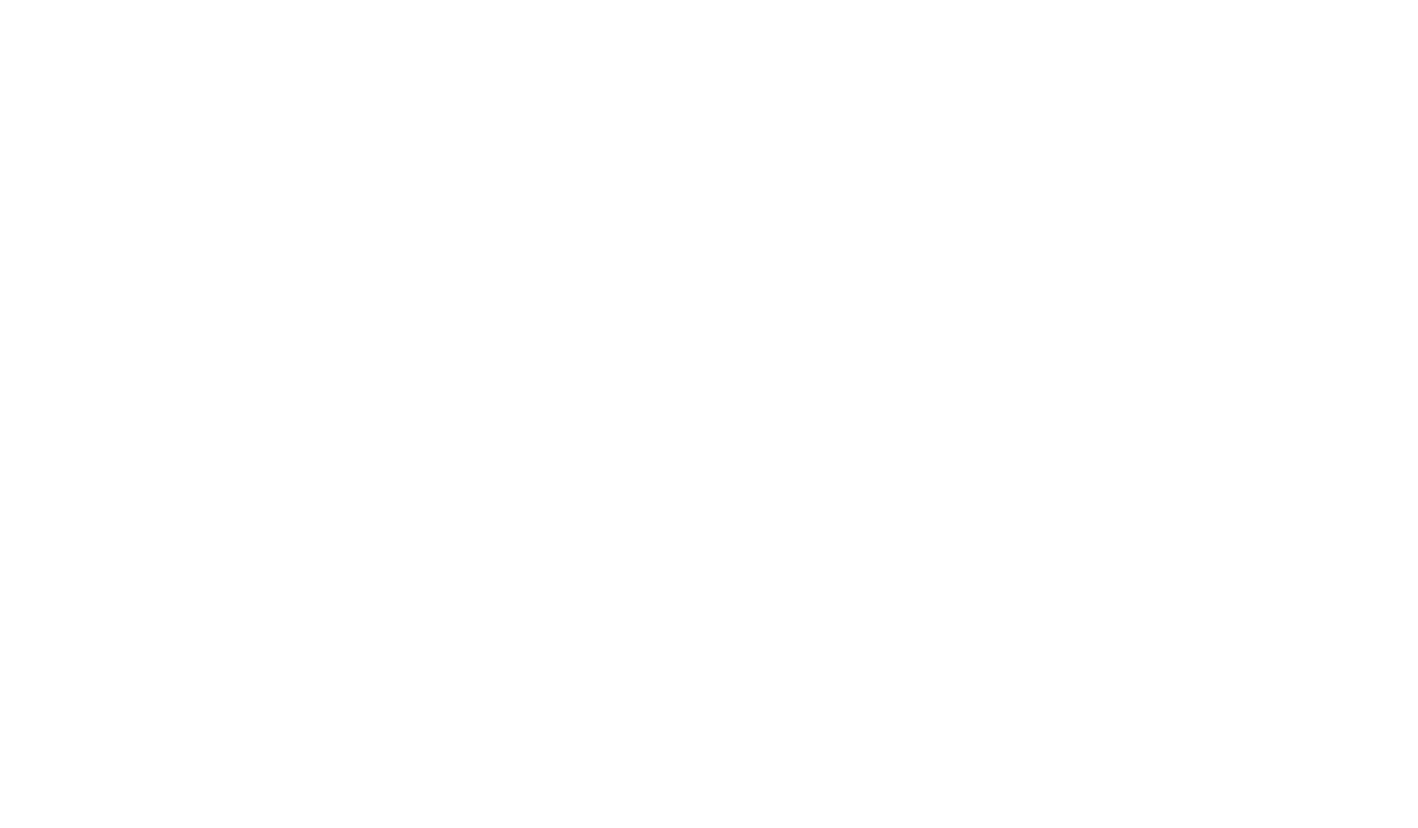Repenser les règles de l’UE sur les véhicules propres : pourquoi le CCRE appelle à plus de flexibilité, de financement et d’autonomie locale
With road transport accounting for nearly a quarter of Europe’s greenhouse gas emLe transport routier représente près d’un quart des émissions de gaz à effet de serre en Europe, ce qui pousse l’Union européenne à promouvoir des solutions de mobilité plus propres dans tous les secteurs. Mais dans sa forme actuelle, la proposition de révision de la directive sur les véhicules propres risque de compromettre les systèmes de transport public qu’elle vise pourtant à verdir. Le Conseil des Communes et Régions d’Europe (CCRE) exprime de sérieuses préoccupations concernant le champ d’application de la directive, les quotas rigides en matière de passation de marchés publics, ainsi que les coûts disproportionnés qu’elle pourrait imposer aux gouvernements locaux et régionaux.
Plutôt que de donner plus de moyens aux autorités locales, la directive risque d’entraîner de nouvelles charges financières, une complexité administrative accrue, et des effets contre-productifs tels que la réduction de services ou l’augmentation des tarifs — ce qui pourrait décourager l’usage des transports publics.
Messages clés :
- Les autorités publiques ne sont pas le problème. Le transport public local est déjà l’un des modes les plus propres. L’effort doit davantage porter sur les constructeurs de véhicules et les opérateurs de transport privés, et non uniquement sur les municipalités.
- La passation de marchés doit rester flexible. Bien que les marchés publics écologiques doivent être encouragés, imposer des critères environnementaux ou sociaux obligatoires dans les marchés publics irait à l’encontre du principe de subsidiarité et du droit de la commande publique. Les gouvernements locaux doivent conserver la liberté d’équilibrer les coûts, les besoins en services et les objectifs environnementaux.
- La neutralité technologique est essentielle. La directive ne doit pas favoriser certaines technologies au détriment d’autres. Une approche basée sur les émissions sur l’ensemble du cycle de vie — y compris les émissions réelles en conduite et les biocarburants — doit guider la définition des « véhicules propres ». Les véhicules spéciaux comme les chasse-neige ou les camions de collecte des déchets devraient être exclus.
- Les quotas peuvent être contre-productifs. Fixer des objectifs obligatoires en matière d’achat de véhicules propres pourrait entraîner un cercle vicieux : des coûts plus élevés pour les autorités locales, une réduction des services, des hausses tarifaires et donc une baisse de la fréquentation des transports publics — ce qui irait à l’encontre des objectifs climatiques.
- Le financement doit accompagner l’ambition. La transition vers des flottes plus propres nécessite des investissements importants. Le CCRE demande un soutien de l’UE, y compris une « règle d’or » permettant d’exclure les investissements dans le transport public des critères de déficit de Maastricht, ainsi que des financements mieux ciblés.
- La déclaration doit être simplifiée. Les nouvelles règles nationales de suivi et de rapport ne doivent pas surcharger les plus de 100 000 autorités locales de l’UE. Le CCRE recommande une approche simplifiée, fondée sur les risques, afin de limiter la bureaucratie.
Conclusion :
Le CCRE s’oppose à la directive dans sa forme actuelle et appelle à des amendements qui respectent l’autonomie locale, permettent une transition rentable et soutiennent un transport durable, sans pénaliser un secteur public qui est déjà en première ligne dans cette transition.

Conseillère – Environnement et mobilité