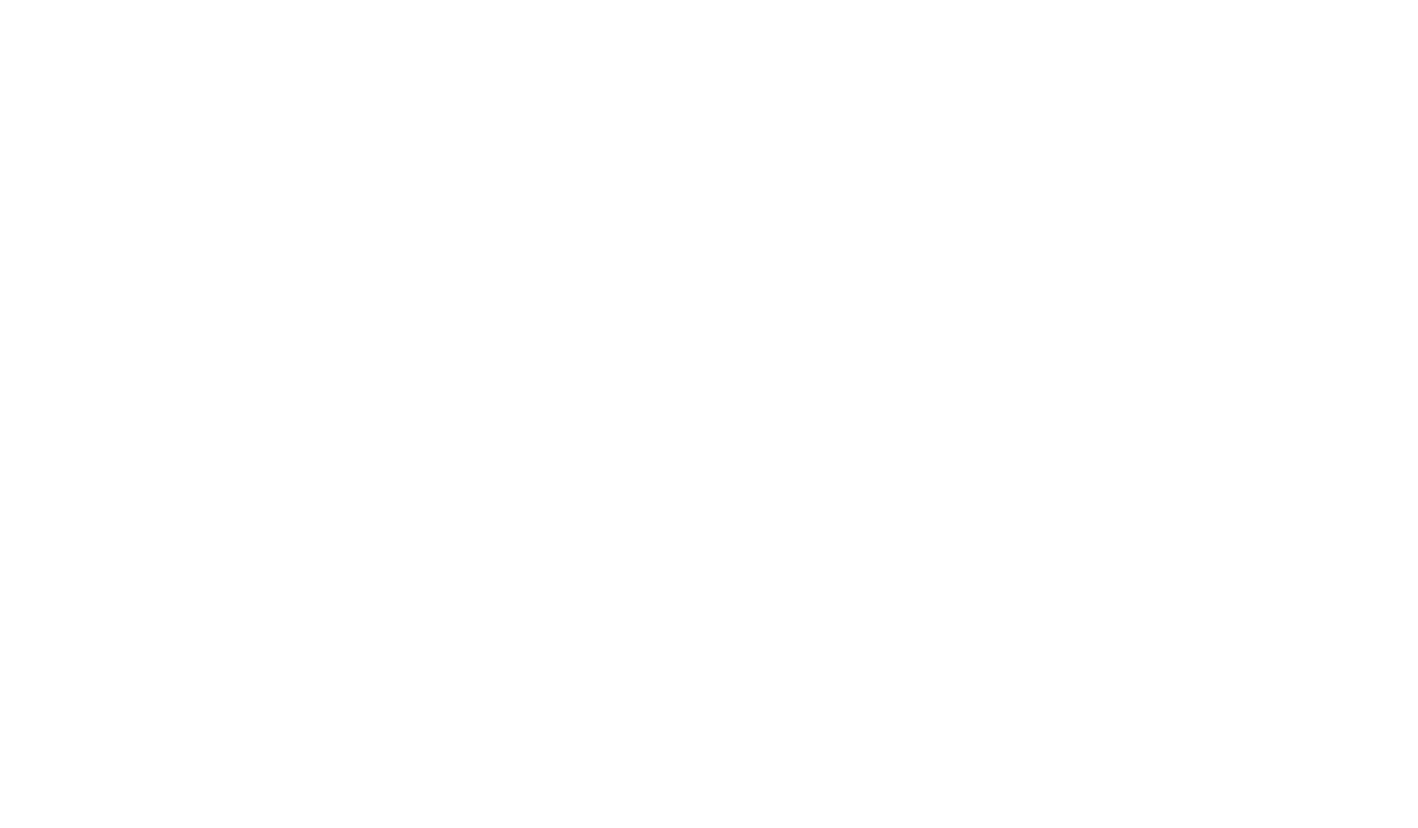Réponses locales à la migration et à l’inclusion : défis et opportunités pour les gouvernements locaux et régionaux
Des représentants des associations nationales de gouvernements locaux et régionaux membres du CCRE, aux côtés d’experts de l’UE et d’organisations de la société civile, se sont réunis le 17 septembre pour discuter de la manière dont la politique migratoire se traduit là où cela compte le plus : dans les municipalités et les régions d’Europe. L’événement, intitulé « Réponses locales à la migration et à l’inclusion : défis et opportunités pour les gouvernements locaux et régionaux », a mis en lumière l’écart entre la conception des politiques européennes et les réalités de leur mise en œuvre locale et régionale.
Les gouvernements locaux en première ligne
Les gouvernements locaux et régionaux (GLR) sont en première ligne face à la migration. Ils fournissent un abri, de l’éducation, des soins de santé et des parcours vers l’emploi, souvent sous pression et avec des ressources limitées. Pourtant, les participants ont souligné que les GLR restent largement absents de la conception du Pacte européen sur la migration et l’asile.
« Les décisions politiques se prennent à Bruxelles ou dans les capitales nationales, mais ce sont les municipalités qui affrontent la réalité sur le terrain », a déclaré Emmanouil Dardoufas, du Comité européen des régions (CdR). « Les dirigeants locaux doivent avoir leur mot à dire dans l’élaboration des politiques migratoires, pas seulement dans leur mise en œuvre. »
Inclusion : la pièce manquante
Les intervenants ont insisté sur le fait que, si le Pacte traite de la gestion des frontières et des procédures, il est beaucoup plus faible sur l’intégration et l’inclusion, précisément les domaines où les municipalités portent la responsabilité la plus lourde. « L’intégration ne s’arrête pas à six mois ou neuf », a rappelé Annalisa Buscaini, du European Policy Centre, en référence aux délais d’accès au marché du travail et au soutien nécessaire pour une inclusion effective. Elle a également mis en garde contre la centralisation des fonds européens au niveau national, qui risque d’écarter les municipalités, en particulier les plus petites.
La dimension de genre : négligée et urgente
Le manque de sensibilité au genre dans la politique migratoire européenne a suscité une vive inquiétude. « Le mot femmes apparaît moins de dix fois dans le Pacte, ce qui implique que les besoins et les défis spécifiques des femmes et des filles migrantes risquent d’être négligés », a noté Frohar Poya, du Réseau européen des femmes migrantes. Elle a décrit des conditions d’accueil dangereuses où la surpopulation, le manque d’intimité et l’insuffisance des garanties exposent les femmes et les filles à la violence et à l’exploitation. Sans approche sensible au genre, a-t-elle averti, l’UE risque de perpétuer des situations de vulnérabilité.
Logement et emploi : des défis locaux pressants
Les pénuries de logements et l’accès au marché du travail figurent parmi les plus grands défis pour les municipalités. En Allemagne et aux Pays-Bas, les participants ont signalé que la rareté du logement alimente des discours hostiles, présentant les migrants comme « prenant la place » des habitants. Les parcours vers l’emploi sont également bloqués par de longues périodes d’attente, une bureaucratie lourde et la non-reconnaissance des qualifications étrangères.
« De nombreux migrants sont prêts à travailler, mais des obstacles juridiques et administratifs les en empêchent. Les gouvernements locaux pourraient jouer un rôle plus important en tant que facilitateurs et employeurs », a soutenu Josephine Liebl, du Conseil européen pour les réfugiés et exilés (ECRE).
Exemples pratiques à travers l’Europe
Les participants ont partagé des exemples de réponses municipales malgré ces pressions :
- Îles Canaries : soutien individualisé pour les mineurs, avec plans éducatifs et sanitaires, évaluation socio-émotionnelle et acquisition de compétences de vie.
- Athènes : un centre municipal de coordination qui offre des services adaptés aux besoins des mineurs et favorise l’échange de savoir-faire entre autorités locales.
- Łódź : intégration scolaire des enfants ukrainiens grâce à des enseignants natifs, des activités culturelles et des cours supplémentaires de polonais.
- Bouches-du-Rhône : participation des mineurs à l’élaboration de leurs plans de soutien, retours sur les services, et prolongement de l’accompagnement jusqu’au début de l’âge adulte pour améliorer les perspectives d’emploi.
Bien que les contextes diffèrent, ces exemples illustrent la créativité des acteurs locaux. Les participants ont cependant souligné qu’il n’existe pas de solution unique, et que les cadres nationaux et européens doivent permettre une flexibilité locale.
Un appel à une gouvernance multiniveaux renforcée
Le débat a convergé sur trois priorités centrales, traduites en demandes concrètes :
- Financement de l’intégration : créer des micro-subventions directes aux municipalités et des enveloppes flexibles accessibles aux petites villes ; exiger des clauses de partenariat dans les règles nationales d’allocation.
- Capacité en logement : explorer des financements ciblés de l’UE et des assouplissements en matière d’aides d’État pour le logement abordable fondés sur des évaluations locales des besoins ; encourager des cadres nationaux permettant le co-investissement municipal.
- Parcours vers l’emploi : tester un accès plus précoce au marché du travail là où c’est possible ; accélérer la reconnaissance des qualifications étrangères dans les secteurs en tension ; simplifier le recrutement local des migrants par les GLR en tant qu’employeurs.
Les participants ont reconnu la nécessité pour les autorités nationales de garantir des règles cohérentes et une supervision. Le défi, ont-ils souligné, est de concilier cela avec la flexibilité dont les acteurs locaux ont besoin.
Comme l’a conclu Merel Bentsink, présidente du groupe d’experts du CCRE sur la migration et l’inclusion (VNG) :
« Les villes et régions d’Europe sont prêtes à faire leur part. Mais si nous voulons que les politiques de migration et d’inclusion fonctionnent, les voix locales doivent être entendues et soutenues. »
Pour plus d’informations, contactez :

Directrice – Politique et impact