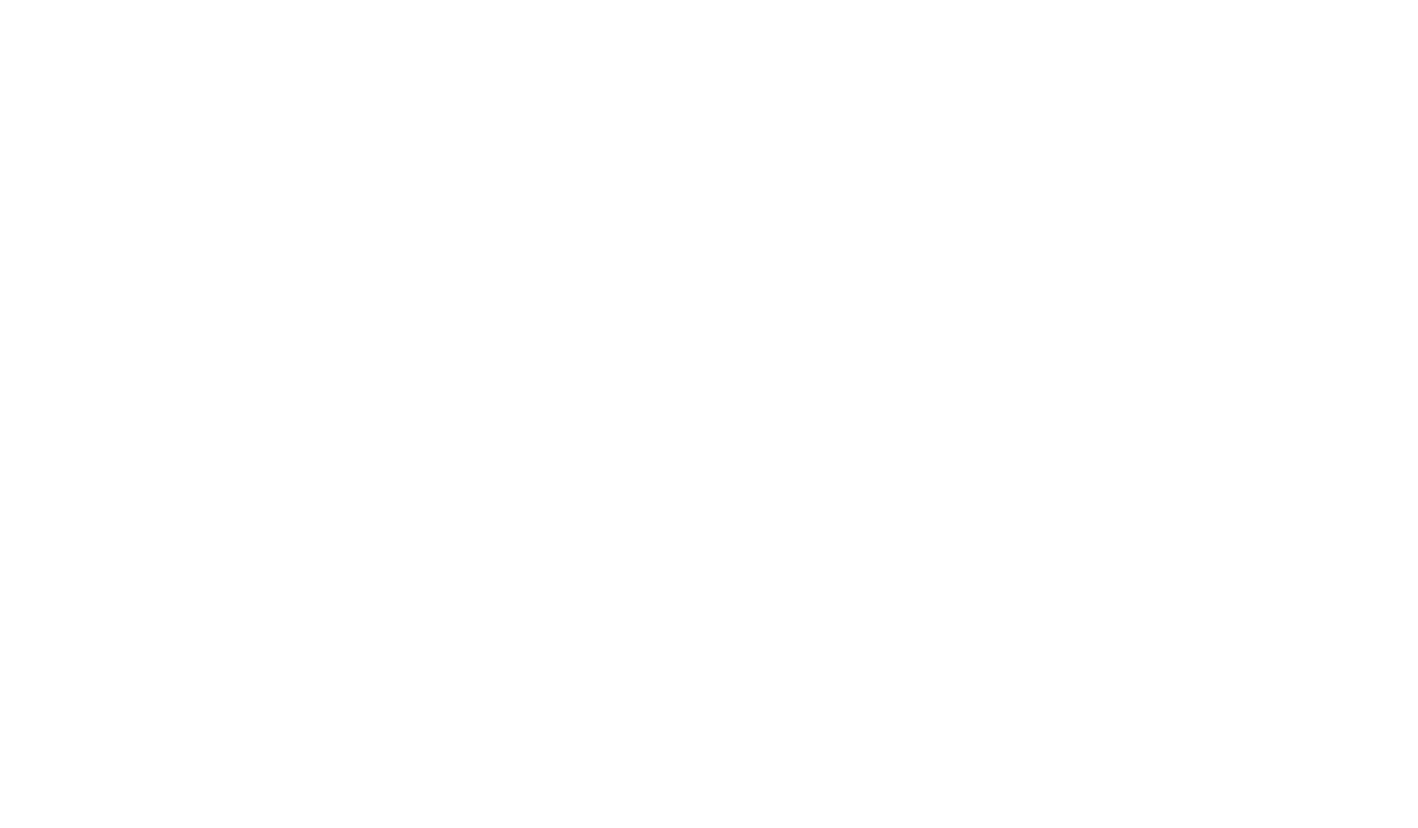Directive sur la performance énergétique des bâtiments : un enjeu majeur pour les gouvernements locaux
Lorsque la Commission européenne a publié sa proposition de refonte de la directive sur la performance énergétique des bâtiments (EPBD), peu anticipaient l’ampleur de ses répercussions sur les citoyens et les collectivités locales.
Maintenant que la directive a été approuvée par le Parlement européen, que peut-on en attendre ? Et quel impact cela aura-t-il sur les gouvernements locaux ? Nous avons examiné ces questions cruciales pour les municipalités, villes et régions.
Le Pacte vert européen progresse
La révision de la directive s’inscrit dans le cadre du Pacte vert pour l’Europe, qui vise à mettre l’UE sur la voie de la neutralité climatique d’ici 2050.
Dans ce contexte, la Commission von der Leyen a proposé, en 2021, le paquet législatif « Fit for 55 », un ensemble massif de lois sur l’énergie et le climat visant à réduire les émissions nettes de gaz à effet de serre d’au moins 55 % d’ici 2030.
C’est dans cette dynamique que la Commission a décidé de relever les objectifs de performance énergétique des bâtiments de l’Union. En effet, les bâtiments dans l’UE représentent 40 % de la consommation énergétique et 36 % des émissions de gaz à effet de serre. Or, près de 75 % du parc immobilier est énergétiquement inefficace… Le chantier de rénovation est immense, compte tenu des millions de bâtiments anciens à travers l’Europe.
La transition vers des bâtiments à zéro émission
L’introduction de la notion de bâtiment à zéro émission (ZEB – zero-emission building) dans la directive révisée est un tournant important. Cette définition correspond à la nouvelle classe énergétique A. À partir de 2028, tous les nouveaux bâtiments devront être à zéro émission. Selon le texte adopté, ces bâtiments devront atteindre le plus haut niveau de performance énergétique, grâce à une consommation modérée et à un chauffage alimenté par de l’énergie décarbonée.
Le CCRE (Conseil des Communes et Régions d’Europe) considère qu’il est essentiel de se concentrer sur la performance énergétique des bâtiments, mais souligne aussi la nécessité de reconfigurer l’ensemble du système énergétique pour atteindre un avenir zéro émission.
Des objectifs ambitieux pour les bâtiments publics
Selon le texte adopté, les bâtiments publics devront atteindre au moins la classe énergétique E d’ici 2027 et la classe D d’ici 2030 – des exigences plus strictes que celles proposées initialement par la Commission (F et E). De plus, tous les nouveaux bâtiments occupés, exploités ou détenus par des autorités publiques devront être à zéro émission dès 2026.
C’est un coup dur pour les collectivités locales et régionales, qui devront lancer d’importants travaux de rénovation. Le CCRE juge ces objectifs trop ambitieux et irréalistes, même pour les municipalités et régions les plus avancées.
Des rénovations massives mais difficiles
Bien qu’il soit crucial d’accélérer la rénovation des bâtiments peu performants, le CCRE estime qu’il est peu probable que tous les bâtiments classés “E”, “F” et “G” soient rénovés d’ici 2030.
Chaque État membre devra définir les mesures nécessaires pour atteindre ces objectifs dans un plan national de rénovation. Pour refléter la diversité des parcs immobiliers nationaux, la lettre G correspondra aux 15 % des bâtiments les moins performants dans chaque pays.
Le CCRE remet en question ce système de classement, qui ne tient pas compte de la qualité initiale des bâtiments. Dans les pays nordiques, par exemple, les conditions climatiques font que de nombreux bâtiments ont déjà une bonne efficacité énergétique.
Le risque de rejet par les États membres
Face aux critiques croissantes dans plusieurs capitales européennes, l’avenir des normes minimales de performance énergétique reste incertain. Il n’est pas garanti que celles-ci survivent aux négociations entre les institutions de l’UE.
Approche “quartier” : un potentiel inexploité
L’approche dite “de quartier”, qui consiste à considérer les bâtiments comme des éléments d’un ensemble urbain plutôt que comme des unités isolées, n’est mentionnée que deux fois dans la proposition. Pourtant, elle pourrait générer d’importantes économies d’échelle.
Le CCRE recommande de renforcer cette approche dans la législation, et salue la possibilité offerte aux États membres de permettre aux autorités régionales et locales d’identifier des “quartiers” pour y mener des programmes intégrés de rénovation.
Prochaines étapes
Le Parlement européen a adopté sa position par 343 voix contre 216 (et 78 abstentions). Il entamera désormais les négociations avec le Conseil pour parvenir à un texte final.
Le CCRE continuera à suivre les évolutions, à échanger avec ses membres et à dialoguer avec les institutions européennes afin de garantir une mise en œuvre réaliste sur le terrain. Si des ressources importantes seront nécessaires à court terme, les économies d’énergie et la baisse des factures à moyen et long terme représentent un avantage majeur pour les collectivités et les citoyens.

Chargée de mission – Énergie et environnement