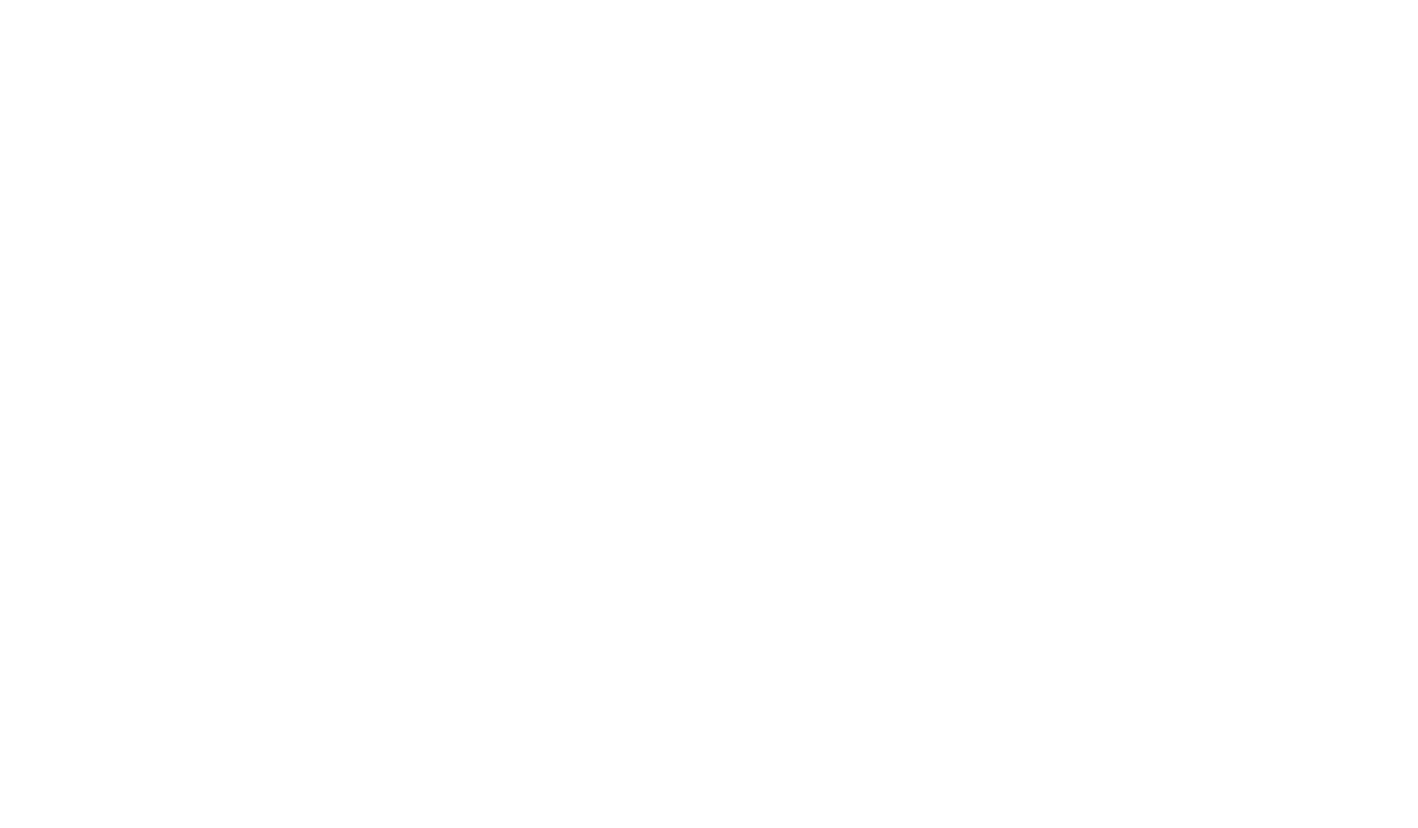8e Rapport sur la cohésion : Quelle politique de cohésion après 2027 ?
Les 28 février et 1er mars, les ministres en charge de la politique de cohésion dans les États membres de l’UE se sont réunis pour échanger autour du 8e rapport sur la cohésion, présenté par la commissaire européenne Elisa Ferreira le 9 février. Le secrétariat du CCRE ainsi que le président du groupe d’experts sur la cohésion territoriale ont participé à cette réunion ministérielle informelle en tant qu’observateurs.
Pour le CCRE, la publication de ce rapport lance une réflexion sur l’avenir de la politique de cohésion, en particulier pour la prochaine période de programmation 2028-2034. C’est une occasion de partager les attentes des collectivités locales et régionales en faveur d’une politique de cohésion plus forte, capable de réduire efficacement les disparités territoriales en Europe.
Renforcer la cohésion sociale, économique et territoriale en Europe et réduire les écarts de développement entre les régions sont des objectifs inscrits dans les traités européens (articles 174 et 175 du TFUE). Pour y parvenir, les principaux instruments sont les fonds structurels et d’investissement européens : Fonds de cohésion, Fonds européen de développement régional (FEDER), Fonds social européen (FSE) et Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER). La publication tous les trois ans d’un rapport sur la cohésion est également une exigence des traités, afin d’évaluer les progrès accomplis.
Résultats mitigés
Le dernier rapport indique que la politique de cohésion de l’UE reste efficace pour aider les régions les moins développées à rattraper leur retard et réduire les disparités sociales et territoriales. Il souligne aussi son rôle positif dans la réponse à la crise du COVID-19, grâce à une flexibilité permettant de réorienter les fonds vers les secteurs les plus critiques.
Cependant, le rapport rappelle que la politique de cohésion doit revenir à sa mission première : réduire les écarts régionaux et favoriser le développement à long terme.
Côté points négatifs :
- Les inégalités persistent.
- La croissance dans les régions les plus développées semble stagner.
- Les moteurs de croissance restent concentrés dans les zones urbaines.
- Les disparités d’emploi sont plus fortes qu’avant 2008.
- Les performances du transport (routier et ferroviaire) restent faibles dans les régions frontalières.
- Le vieillissement démographique se confirme partout en Europe.
En 2020, 34 % de la population de l’UE vivait dans une région en déclin démographique, une part qui pourrait atteindre 51 % d’ici 2040.
Ces défis affectent particulièrement les zones rurales et régions frontalières. Il est donc probable que la politique de cohésion future porte une attention accrue à ces territoires, en misant sur les villes petites et moyennes comme moteurs de développement local.
Semestre européen et gouvernance économique de l’UE
L’avenir de la politique de cohésion sera lié à la réforme de la gouvernance économique de l’UE et du Semestre européen, tous deux remis en question par la crise du COVID-19, qui a forcé l’UE à suspendre les règles de limitation des dettes et de contrôle des dépenses publiques.
Le rapport montre que la politique de cohésion a permis de maintenir les investissements publics face à des règles contradictoires depuis la crise de 2008-2009. Aujourd’hui, le paradigme change : la transition verte et numérique nécessite des investissements massifs, publics comme privés. Les collectivités locales et régionales devront y participer pleinement, ce qui exige de renforcer leurs capacités d’investissement.
Recentralisation vs gouvernance à plusieurs niveaux
Le rapport indique que la future politique de cohésion pourrait se concentrer sur :
- le changement climatique et la transition environnementale
- la connectivité et les transformations technologiques
- la diversification économique
- les défis démographiques
- la démocratie et la confiance envers l’UE
Concernant la démocratie, la Commission reconnaît que les instruments territoriaux et le principe de partenariat peuvent renforcer l’appropriation des politiques européennes. Cependant, cette reconnaissance entre en contradiction avec une tendance à la recentralisation du pilotage des fonds par les États membres.
Depuis 2021, cette tendance est visible :
- Plans stratégiques nationaux de la PAC
- Plans nationaux pour la relance et la résilience
- Plans nationaux sociaux pour le climat
La Commission donne aux États membres une liberté accrue dans l’élaboration de leurs stratégies d’investissement sans obligation d’associer les collectivités locales ni la société civile. Cela contredit le principe de partenariat, et l’on attend de voir si le nouveau principe de « ne pas nuire à la politique de cohésion », proposé par la Commissaire Ferreira, sera réellement appliqué à toutes les politiques européennes ayant un impact territorial.

Conseillère – Cohésion territoriale et finances locales