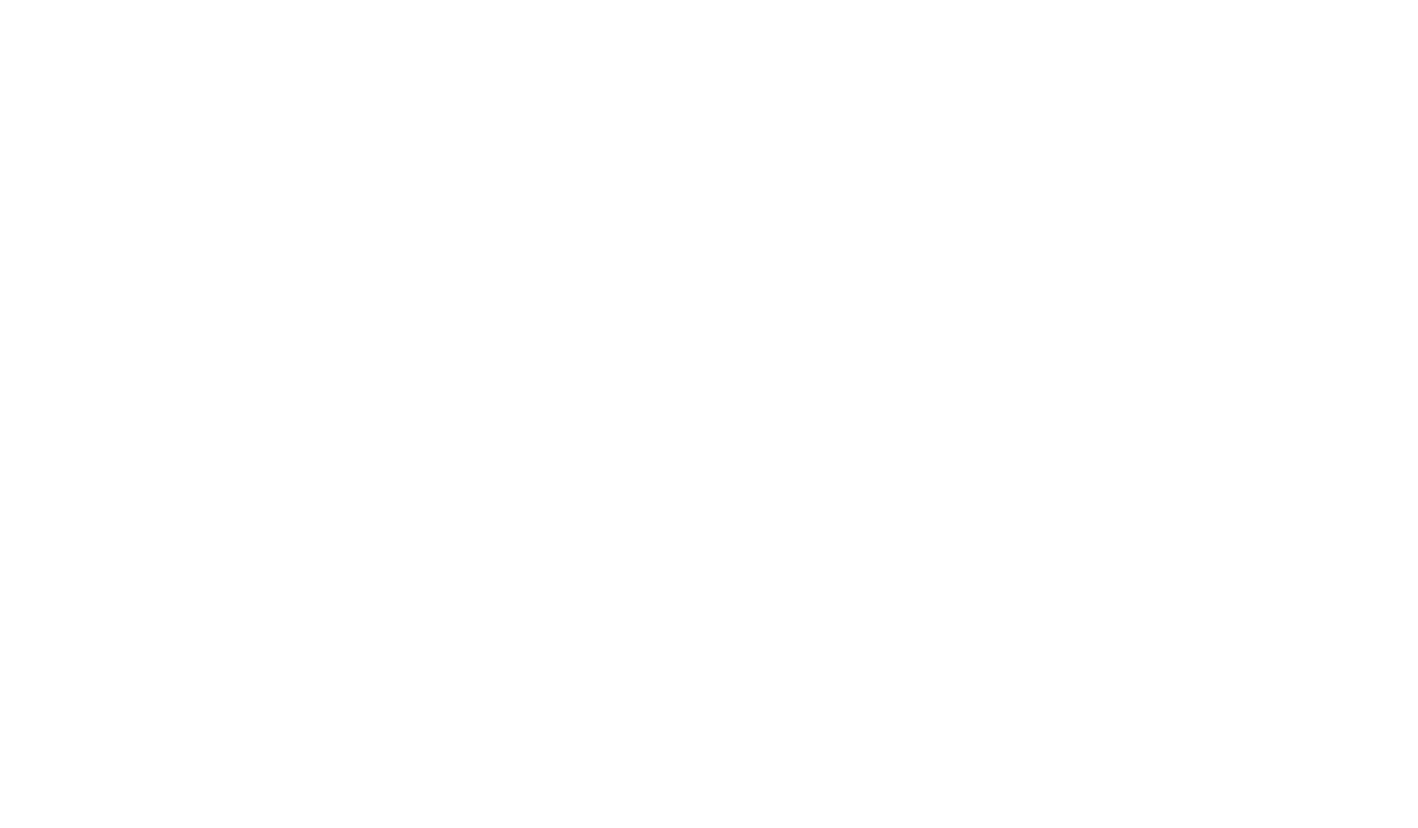Examen à mi-parcours de la politique de cohésion : le verre à moitié vide ou à moitié plein ?
La logique de la dernière communication de la Commission, intitulée « Une politique de cohésion modernisée : l’examen à mi-parcours », est claire et convaincante : les programmes opérationnels des fonds de la politique de cohésion ont été négociés il y a quatre ans, avant une pandémie mondiale, avant le tournant radical de l’emprunt conjoint massif de l’UE, et avant la guerre d’agression de la Russie contre l’Ukraine et son impact dramatique sur l’inflation et le coût de la vie.
Comme l’a rappelé le vice-président exécutif Raffaele Fitto aux membres de la commission du développement régional du Parlement européen le 9 avril : le monde a changé, l’Union aussi doit adapter ses priorités et ses politiques.
Cette nouvelle proposition — encore une nouvelle modification des règlements de la politique de cohésion en cinq ans — vise à offrir de nouvelles possibilités de dépenses pour les autorités de gestion. Elle le fait en créant de nouveaux objectifs spécifiques et en élargissant le champ des dépenses et bénéficiaires éligibles, en lien avec cinq nouvelles priorités clés identifiées par la Commission :
- Compétitivité et décarbonation de l’industrie
- Défense et sécurité
- Logement abordable
- Résilience de l’eau
- Transition énergétique
Ces priorités répondent à des enjeux indéniablement urgents : les maires alertent depuis longtemps sur la crise du logement, et les récentes inondations dramatiques à travers l’Europe ont souligné l’urgence d’une gestion de l’eau résiliente au climat.
Dans le même temps, cela reflète également les priorités politiques de la nouvelle Commission : compétitivité et défense. On pourrait se réjouir que leur inclusion dans la politique de cohésion souligne le rôle des gouvernements locaux et régionaux dans la compétitivité européenne, le développement économique local et l’attractivité des territoires.
Et pourtant…
Malgré cette ambition tournée vers l’avenir, l’examen à mi-parcours laisse une impression mitigée : verre à moitié plein ou à moitié vide ? La proposition ouvre certes de nouvelles possibilités de financement, à utiliser sur une base volontaire par les États membres ou régions (selon l’autorité de gestion compétente). Mais à ce stade avancé de la période de programmation, son adoption risque d’être limitée, soulevant des doutes sur la réelle valeur ajoutée de l’ensemble de la proposition.
Il y a aussi un risque de remettre en cause les priorités déjà convenues, en ajoutant de nouvelles activités et bénéficiaires éligibles — avec des conditions très attractives (préfinancement, cofinancement à 100 % de l’UE) — sans budget additionnel.
La Commission semble hantée par sa décision initiale de réduire à deux ans (N+2) le délai pour clôturer les programmes après la période, contre trois ans auparavant (N+3). Et ce, malgré l’assurance des autorités de gestion qui affirment être toujours en mesure de dépenser l’ensemble de leur budget — forts de décennies d’expérience en gestion des fonds de la politique de cohésion. Pour la Commission, ce n’est toujours pas assez rapide.
Avec cette proposition, la Commission ouvre non seulement de nouveaux domaines d’investissement, mais permet aussi à de grandes entreprises — notamment du secteur de la défense — d’accéder aux fonds de cohésion, sans obligation de démontrer leur contribution à la cohésion économique, sociale et territoriale du territoire où elles s’implantent grâce aux investissements de l’UE.
Et ce dernier point pourrait être le changement le plus radical de la politique de cohésion telle que nous la connaissons. Même si l’adoption de cette réforme reste probable limitée du fait de l’engagement déjà important des fonds, il s’agit d’un avant-goût de la proposition de la Commission pour le prochain cadre financier : le retour d’une “politique européenne d’investissement structurel”, mais moins centrée sur les objectifs du traité (cohésion économique, sociale et territoriale), et davantage alignée sur les priorités politiques du moment. Moins de principe de partenariat et de gouvernance à plusieurs niveaux, plus d’ouverture au secteur privé capable de dépenser rapidement de grandes sommes.
Cette communication n’est pas rassurante en matière de respect de la gouvernance à plusieurs niveaux et du principe de partenariat. Comme l’a montré la Facilité pour la reprise et la résilience, il ne suffit pas de mentionner la coopération avec les autorités nationales, régionales et locales. La Commission doit mettre en place des méthodologies et exigences contraignantes pour garantir une gouvernance réelle à plusieurs niveaux. Or, dans cet examen à mi-parcours, la Commission n’encourage même pas les États membres à discuter des possibilités de reprogrammation avec les parties prenantes.
Leçons à tirer
Une politique sérieuse d’investissement structurel ne peut pas être soumise à des modifications réglementaires constantes au sein d’une même période de programmation. La vraie flexibilité ne doit pas venir des changements politiques ponctuels de la Commission, mais bien de la conception des programmes eux-mêmes, avec des priorités d’investissement définies de manière ascendante, portées par les gouvernements locaux et régionaux, qui connaissent le mieux les besoins spécifiques et à long terme de leurs territoires.
Certes, l’UE doit définir de grands objectifs stratégiques tels que la décarbonation de la société, la compétitivité des territoires ou la résilience de l’administration publique. Mais elle doit éviter les concentrations thématiques trop étroites, qui limitent les opportunités d’investissement dans les villes et régions et ne sont pas toujours adaptées aux réalités locales.
Ce n’est qu’à cette condition que le prochain budget européen pourra répondre à la fois aux objectifs communs de l’Union et aux besoins uniques de chaque territoire.

Conseillère – Cohésion territoriale et finances locales