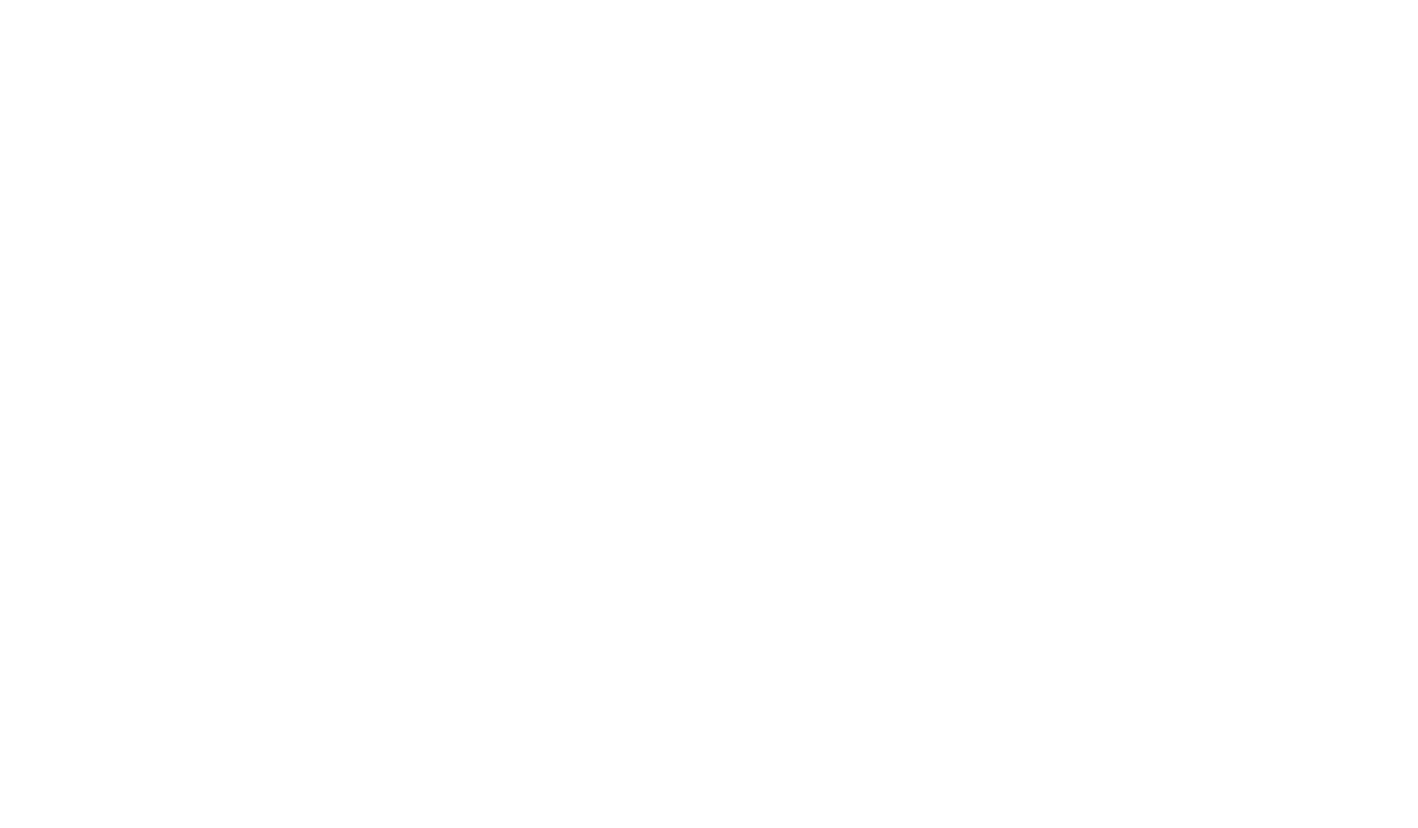Les villes et municipalités aux commandes des fonds de la politique de cohésion de l’UE ?
Quel est le point commun entre les trolleybus de la zone métropolitaine d’Ostrava (République tchèque), les entreprises alimentaires locales de la région urbaine de Ljubljana (Slovénie) et le festival de danse traditionnelle de Saint-Gervais-d’Auvergne (France) ? Ils ont tous bénéficié de la politique de cohésion européenne via des investissements territoriaux intégrés (ITI) ou des démarches de développement local mené par les acteurs locaux (DLAL).
Derrière le terme « politique de cohésion de l’UE », se cache une diversité de programmes et de financements tels que le Fonds européen de développement régional (FEDER), le Fonds social européen (FSE) ou encore le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER), bien que ce dernier soit désormais directement rattaché à la Politique agricole commune.
Dans la pratique, ces fonds atteignent des milliers de villes, municipalités et régions, ainsi que d’autres bénéficiaires, par l’intermédiaire des « autorités de gestion », qui peuvent être des ministères nationaux ou des régions. Mais deux dimensions moins connues de ces fonds sont mises en œuvre directement sur le terrain : les ITI et les DLAL.
ITI et DLAL
Les Investissements Territoriaux Intégrés (ITI) et le Développement Local mené par les Acteurs Locaux (DLAL) sont les principaux mécanismes utilisés pour mettre en œuvre les financements de la politique de cohésion européenne de manière intégrée et territorialisée. L’utilisation de ces outils garantit une implication étroite des gouvernements locaux et des parties prenantes dans la conception, la mise en œuvre et le suivi des fonds européens qu’ils reçoivent.
Ils permettent de mobiliser différents fonds de manière intégrée. Par exemple, une municipalité rurale souhaitant lancer un projet d’inclusion sociale pourrait combiner le FSE et le FEADER dans un seul projet global.
Sur le papier, les ITI et les DLAL sont des outils formidables pour les collectivités locales et régionales… mais qu’en est-il dans la réalité ?
En 2015, nous avons mené une première analyse de l’utilisation des ITI dans différents États membres. Quelques années plus tard, avec le lancement de la nouvelle période de programmation 2021-2027, nous avons renouvelé l’expérience pour comprendre comment ces outils avaient été utilisés dans la période précédente, quels enseignements en avaient été tirés et quelles évolutions avaient été apportées à leur mise en œuvre.
[Cliquez ici pour lire l’étude complète.]
Pour cela, le CCRE a consulté certaines de ses associations membres afin de recueillir des retours sur la mise en œuvre et la planification des outils ITI et DLAL, du point de vue des villes et des municipalités.
Des outils très appréciés, mais des difficultés subsistent
Dans l’ensemble, les nombreux retours reçus ont été très positifs. Les ITI et les DLAL sont considérés comme d’excellents instruments, grâce à leur capacité d’adaptation aux besoins et spécificités locales. Ils permettent aux autorités locales de renforcer leurs compétences en matière de gestion des fonds européens. De plus, ils favorisent le dialogue à plusieurs niveaux entre les collectivités locales et les autorités de gestion (ministère ou région), renforçant ainsi la confiance entre les différents niveaux de gouvernance.
Mais tout n’est pas encore parfait : certains défis demeurent pour exploiter pleinement le potentiel de ces outils, comme la lourdeur administrative encore inhérente aux fonds de la politique de cohésion. Dans la nouvelle analyse du CCRE, nous formulons également plusieurs recommandations pour améliorer le recours aux ITI et DLAL dans la période de programmation actuelle et future.
Pour plus d’information, contactez :

Conseillère – Cohésion territoriale et finances locales